Les quinze années scolaires que j’ai passées à Clemenceau ont été riches et heureuses, et j’y ai rencontré des collègues charmants et des élèves qui ne l’étaient pas moins.
Georges et les autres sera, je l’espère, l’occasion de conserver des contacts, d’avoir des nouvelles des uns et des autres, et d’en donner peut-être, si ma toute nouvelle vie de paisible retraité s’y prête…
Jean-Louis Bailly nous autorise à publier le texte qu’il a écrit pour le cinquantenaire des Amis de la Bibliothèque municipale de Nantes, célébré, le 1er octobre 2016, dans le beau cadre d’une serre du Jardin des Plantes.
Photo Noëlle Derickxsen
Merci à Jean-Louis Bailly ainsi qu’à Colette Le Lay, présidente des ABMN.
Excellente introduction à l’oeuvre de l’écrivain Jean-Louis Bailly
À l’occasion du cinquantenaire de leur association, les Amis de la Bibliothèque Municipale de Nantes me demandent de présenter mon travail en quinze ou vingt minutes. Cela tombe à pic. Je viens de prendre ma retraite, les livres que j’écris ont de plus en plus tendance à préférer le confort de mes tiroirs aux étals des libraires. Je vois là l’occasion de résumer ce qu’a été ma vie d’auteur – ou plutôt, de raconter ce que peut être la destinée banale d’un auteur d’aujourd’hui, qui se trouverait avoir écrit les mêmes livres que moi…
Il a une grosse vingtaine d’années quand il publie ses nouvelles dans des revues, notamment la revue Minuit, des éditions du même nom. Lorsque, un peu plus tard, il termine un roman, c’est naturellement à Minuit qu’il le propose. Jérôme Lindon, le mythique directeur de ces éditions, qui suit ce qu’il écrit dans la revue, lui téléphone. Il va peut-être publier ce roman, lui dit-il. Ce ne sera pas le cas. Mais l’échec semble prometteur, et notre jeune écrivain préfère le voir comme un demi-succès….
Jérôme Lindon lui a suggéré de lire Echenoz, qu’il ne connaissait pas. Le premier roman de lui qu’il lit l’enthousiasme, il lui écrit son admiration, et lui glisse au passage qu’ils ont été « voisins » dans la revue Minuit. Echenoz lui répond très aimablement qu’il est allé lire son texte dans ce numéro de la revue, et a ce mot qu’on n’oublie pas : « Continuez-vous d’écrire ? Ce serait dommage que non. » Phrase fatidique, qui jette de plus belle notre jeune homme dans son désir d’écrire et de publier un roman…
Ce sera L’Année de la bulle, aux éditions Robert Laffont. L’auteur a adressé le manuscrit à un écrivain, Jacques Bens, avec lequel il avait un peu correspondu. Bens lui suggère quelques noms, dont celui de Michel-Claude Jalard, éditeur chez Robert Laffont, qui assez vite fait part à l’écrivain en herbe de l’acceptation de Laffont par un courrier qui le transporte d’aise…Il découvre ce qu’est une grande maison d’édition : service de presse pléthorique, photographies par Ulf Andersen, le photographe des écrivains à l’époque, attachées de presse (une pour Paris, une pour la province), journaux, radios, télévision même. Paris-Match invite, pour une photo de groupe devant la tour Eiffel, une dizaine d’auteurs de premiers romans, sous le titre : « Ils ont envoyé leur premier roman par la poste, et ça a marché ». Un journal d’alors, Le Quotidien de Paris, consacre à L’Année de la Bulle et à son auteur la Une de son supplément littéraire. Tout cela est grisant… Le livre est partout. Après quelques semaines, les piles d’ouvrages suivent le trajet habituel : de l’éditeur aux librairies, des librairies à l’éditeur, de l’éditeur aux soldeurs et au pilon… Je m’aperçois que je n’ai pas parlé du sujet du roman, qui ne laisse pas de souvenir bien précis. Plus ou moins picaresque, plus ou moins humoristique, plus ou moins n’importe quoi… Il a la chance de faire partie des quinze titres sélectionnés pour le festival du premier roman de Chambéry : occasion pour notre édité de fraîche date de nouer quelques belles amitiés avec d’autres auteurs ; certaines durent encore.
Paraît l’année suivante, toujours chez Laffont, La Dispersion des cendres. Un homme découvre dans son grenier une collection de masques mortuaires ; l’un de ces masques est le sien. Suivent trois explications, de trois types : fantastique, psychologique et policier. La critique est favorable, les ventes toujours très moyennes ; au moins ce livre-là échappe-t-il au pilon : vingt-cinq ans plus tard, il est toujours au catalogue, on se demande bien pourquoi.

Lecture 1. Le narrateur vient de découvrir sa collection de masques, et les décrit un à un. Voici le douzième.
Le douzième [masque] est celui d’une jeune femme à la beauté pure et un peu sauvage. Elle sourit. Elle vit. Elle est heureuse. Peut-être une main la caresse-t-elle alors qu’elle pose. On l’aime. C’est le seul masque, avec celui de Pascal, dont je n’aie pas à reconstituer l’histoire ou la légende. Ce masque sans valeur est celui de L’Inconnue de la Seine, découverte noyée dans le fleuve en 1930. On connaît, si l’on a lu Aurélien, les pages qu’Aragon lui a consacrées. Les bibliophiles citent Céline, qui l’a choisie pour frontispice. L’amateur de photographies se rappelle celle de Willy Zielke, qui fait de cette morte une mariée en drapant le masque d’un voile de tulle, or elle s’est suicidée. Enfin les promeneurs l’aperçoivent encore derrière la vitrine des frères Lorenzo. C’est en effet le premier masque mortuaire – volé à l’inconnue par l’amoureux médecin chargé de l’autopsier – à avoir fait l’objet d’une reproduction industrielle, avant même la main de Chopin, que l’on trouve assez facilement aussi. Objet banal, donc, mais d’une présence si forte et si troublante qu’elle fait pleurer, sans doute parce que ce gâchis personnel (comment se tuer quand on a cette beauté sereine) appelle mieux que d’autres masques l’idée de l’universel gâchis. Peut-être ce masque des plus répandus a-t-il été celui par lequel tout a commencé, et qui a soufflé à mon collectionneur l’inspiration de chercher plus loin, de hanter les antiquaires, les salles des ventes, les veuves lassées.
(J’ai su presque tout de suite que cette histoire de noyade était une légende – la noyade était une phtisie ordinaire -, mais on ne m’empêchera pas de m’y tenir.)
Je détiens aussi un treizième masque.
La Dispersion des cendres (1990)
C’est alors que les choses ont commencé de se gâter. Les Spongieux, troisième roman, une terrible histoire où des défunts sont réanimés par des artifices techniques pour pouvoir éblouir la famille avant leur inhumation, est d’abord accepté, mais se heurte au veto de Robert Laffont, qui vivait dans l’angoisse de sa propre fin. Il faut trouver un autre éditeur. Ce sera Régine Deforges, qu’un sujet aussi peu correct amuse plutôt. Notre auteur, revenu au festival de Chambéry cette fois comme « parrain », parcourt les rues de la ville en compagnie de sa flamboyante éditrice, qui s’était fait connaître comme auteur de romans érotiques mais ne parle plus que de broderie au crochet. Hélas, elle affronte quelques déboires judiciaires liés au plagiat dont La Bicyclette bleue est accusée par les Américains, et doit, en tant qu’éditrice, mettre la clé sous la porte alors que l’encre des Spongieux est à peine sèche… Le passage en librairie, entre l’imprimeur et le pilon, a cette fois été extrêmement bref, et ce roman de morts-vivants est un roman mort-né…
Petite embellie avec L’Ombre de Théophile, que publie ensuite Belfond. Belfond présente alors une caractéristique aujourd’hui très rare, celle d’employer des correcteurs exigeants. La correctrice de L’Ombre de Théophile téléphone à son auteur durant une heure, discutant de détails très pointus. Le résultat est un livre probablement dépourvu de toute coquille, ce qui ne se produit plus guère…. Le roman, tournant autour de la dernière année du poète baroque Théophile de Viau, est bien accueilli. Jean-Louis Ézine consacre une pleine page du Nouvel Observateur à deux romans, dont celui-là, et la photo couleur de l’auteur est très remarquée par ses collègues… Il est clair, à la lecture du papier, qu’Ézine n’a lu aucun des deux romans dont il parle, mais un écrivain doit apprendre à affronter ce genre de petite humiliation. Patrick Poivre d’Arvor anime cette année-là pour LCI une quotidienne consacrée à un livre. Il bavarde pendant le maquillage avec la fournée de cinq auteurs qu’il fait passer ce jour-là, et les interroge en plateau pendant cinq minutes. Il n’a pas lu les livres non plus, mais le cache avec plus d’habileté que Jean-Louis Ézine. Ayant travaillé sur Théophile de Viau dans le cadre d’une thèse avortée, l’auteur n’a eu qu’à se baisser pour cueillir tout ce qui concerne la partie « informée » de son livre. Tout le reste a été imagination et plaisir… C’est un bon souvenir dans une vie d’écrivain…
Lecture 2. Le jeune admirateur de Théophile vient enfin de le rencontrer, et lui explique de quoi il vit.
– L’héritage dont je vous parlais, s’il m’épargne de mourir de faim, ne peut proprement me faire vivre. Je rencontre parfois des métiers à ma convenance, qui me tiennent dans le seul commerce qui vaille : celui des livres. Ainsi, voilà quelques mois, je fus graisseur chez un doreur chauve.
– Je suis d’avis que tu te railles à mes dépens, ce qui est fort vilain …
– Je ne l’oserais! Vous avez vu travailler un relieur, un doreur. Les feuilles d’or dont il se doit saisir sont si minces, si légères, qu’un souffle les emporte, que des doigts les froisseraient, que les pinces les plus délicates les déchireraient. Le geste de toute la confrérie est le même : se passer une lame dans les cheveux, où elle se graisse; la poser ensuite sur la feuille d’or, qui s’y prend comme grenaille à une pierre d’aimant. Or Bregin, relieur près la porte St-Michel, est chauve comme la mort. Autant vaudrait qu’il fût aveugle ou paralytique. Je lui prêtais mon crâne et mes cheveux. Il va de soi que je le servais d’autre manière, préparant les cahiers que je ne me faisais pas faute de lire au passage, enveloppant les reliures finies, les allant porter chez sa pratique, mais quoi : j’étais d’abord payé pour graisser … ce qui, faut-il le dire, ne m’engraissait guère moi-même.
L’Ombre de Théophile (1994)
Suivent des années troublées… Un ancien éditeur de chez Laffont, qui avait travaillé sur les premiers livres de notre auteur, lance sa propre maison. Il lui téléphone : avez-vous quelque chose dans vos tiroirs ? Oui : un roman tout juste terminé : Le Festin de l’anémone. L’aspirant éditeur reçoit le texte, s’emballe, publie… mais sa maison, à peine créée, dépose le bilan, il sombre dans la dépression et la cure de sommeil. Encore un livre mort-né… Le sujet est de ceux qui ne restent pas en mémoire : une histoire de manipulation psychologique qui doit conduire à un crime plus ou moins parfait. Les romans permettent aux auteurs de donner libre cours à leurs penchants meurtriers… Mais un détail important de l’intrigue repose sur une grosse erreur, qui aurait pu être corrigée à condition de modifier quelques mots du texte. Bref, évitons de parler de celui-là, même si l’action se déroule non loin d’ici, dans la presqu’île guérandaise.
Sans se décourager, c’est dire son obstination, celui qui ne sera jamais sûr d’être un « écrivain » achève pour la première fois un roman dont l’action se déroule dans le milieu de l’enseignement. Il s’intitule La Désillusion. Ce n’est pas, heureusement, son expérience qu’il raconte, mais celle d’un professeur de collège, atrocement chahuté, qui séquestre le plus gentil de ses élèves pour se venger sur lui des humiliations que lui font subir ses classes. De « grands éditeurs » parisiens mordent à l’hameçon, téléphonent… mais finalement ne publient pas. Le livre échouera, affublé d’un titre ridicule (Le Potache est servi) chez un petit éditeur breton aux pratiques éditoriales douteuses. Ce roman aurait peut-être mérité un destin un peu moins médiocre : en tout cas son auteur lui conservera quelque tendresse – ne serait-ce que parce qu’il lui a valu la précieuse amitié de Robert de Goulaine.
Lecture 3. Le professeur est sur le point d’être confondu, et il le sait. Il écoute une de ses élèves, Marion, réciter le poème de Rimbaud intitulé « roman »
Cette voix, il m’aura fallu apprendre à l’aimer, ta voix Marion, mais je sais, t’écoutant, que je ne l’oublierai pas, que ce poème désormais aura pour moi ce timbre-là. Trop nasale, sans doute -et même nasillarde quand naguère elle se moquait de moi, qu’elle cherchait à me blesser, et y manquait rarement. Mais sous cette voix du nez, derrière elle, tout près, la voix du cœur (formule ridicule, oui, mais le ridicule, à présent), qui a des transparences de torrent et des profondeurs soudaines, la fermeté des chairs d’enfants et des langueurs toutes féminines, une voix qui murmure presque et se brise dans l’émotion gouailleuse de Rimbaud : On se sent aux lèvres un baiser / Qui palpite là, comme une petite bête… Et cette voix, ces lèvres, ce regard -comment les dissocier- ce charme incarné, ces élans : Nuits de juin ! Dix-sept ans ! -On se laisse griser !, réussissant l’impossible accord du lyrisme et de l’humour, cette voix c’est la même qui gueulait en plein cours à Wilfried Balard, je t’emmerde, je te nique petit pédé, la même !
Seule à parler, Marion, seule à dire, qui ferme les yeux, L’air est parfois si doux qu’on ferme la paupière, non dans un geste de théâtre, mais dans l’oubli de soi, la fusion avec le génie le plus proche et le moins accessible. Seule à dire, et parlant pour tous les autres qui l’écoutent, les petits benêts, les grands patauds, les pétasses, les laiderons, les vamps et les pouffeuses, tous, et le géant aux bras pendants juché sur son estrade, pauvre diable qui ne cherche pas à masquer l’émoi qui le gagne, ne s’essuie pas le coin des yeux, ne se racle pas la gorge, et qui avait dix-sept ans lui aussi – hier. Non, ce n’est pas Marion seule qui parle, c’est le silence des autres, vingt-quatre rêves de vie et d’amour, vingt-quatre difficultés de vivre et d’aimer.
Le Potache est servi (2001)
Il continue d’écrire dans les années qui ont suivi cet épisode fâcheux. Mais la chronique de littérature qu’il assure dans la revue 303 suffit presque à combler son besoin d’écriture, et sa rage de publier paraît s’être dissipée. C’est alors qu’il reprend à son compte, sur son blog, la belle idée de Félix Fénéon au début du XXème siècle : réécrire en 3 lignes, moins de 150 caractères, les dépêches de presse qu’il recevait. La concision n’était pas la seule contrainte : les « nouvelles en trois lignes » de Fénéon consistent surtout à transformer des faits divers en littérature. Il serait oiseux de raconter comment ce blog est tombé sous les yeux d’un petit éditeur bordelais, David Vincent, qui a demandé bien poliment à l’auteur s’il verrait un inconvénient à ce que sa maison, L’Arbre vengeur, publie ces nouvelles. Comment refuser ? Il l’aurait fallu, pourtant, car la funeste rage de publier n’était qu’endormie… Paru sous le titre Nouvelles impassibles, le recueil amuse, et ce petit jeu suscite même deux savants articles universitaires, au Portugal et au Québec…
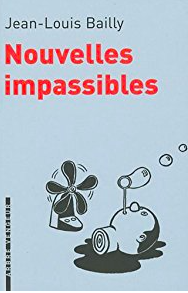
Lecture 4. Au hasard, six « nouvelles impassibles » successives.
Parents d’élèves et hiérarchie prêtaient à une institutrice de Pauillac un naturel revêche. Se sentant harcelée, elle se suicide quoique enceinte.
Principal de collège, il apprenait la vie à des fillettes (6-11 ans) en exhibant ses pudenda dans des téléphériques. Deux ans dont quinze mois fermes.
Ils posèrent levant une main berlinoise, drapés dans le drapeau nazi. On consigne ces trois férus d’histoire contemporaine du 17ème Génie (Montauban).
Jereme James, Californien unijambiste, faisait fond sur sa disgrâce en cachant dans sa prothèse les iguaneaux dont il trafiquait : jugé le 14 juillet.
Nlle-Zélande : 5 ans requis contre Singalargh (27 ans) coupable d’avoir, sur une adolescente, jeté un hérisson. Arme mortelle – qui périt sur le coup.
Pied de nez à la justice belge : Van Den Broek, condamné pour violences à 8 mois et une amende, s’était tué quelques jours auparavant, en auto.
Nouvelles impassibles (2009)
A-t-il retrouvé un éditeur ? peut-être. En tout cas, l’année suivante, l’Arbre Vengeur publie un roman, Vers la poussière, dont la structure repose sur un parti-pris simple : la première moitié de chaque chapitre raconte ce qu’il advient du corps du héros après sa mort, la deuxième ce qu’a été sa vie de pianiste prodige. Chaque chapitre confronte donc les espoirs, les triomphes, les désillusions, le désespoir, avec le sort qui attend chacun de nous. Les réactions sont tranchées : certains lecteurs refusent de lire la partie du livre qui raconte la décomposition du corps et son patient grignotage par des escouades de bébêtes. Or ce petit roman à l’horrible sujet a été écrit dans l’allégresse. Peut-être, du reste, incite-t-il davantage à une réconciliation avec notre lot commun qu’à une inutile révolte ou au dégoût. Il est le seul des livres de son auteur à avoir fait l’objet d’une traduction, parue à l’été dernier chez un éditeur de Saint-Pétersbourg.


Lecture 5. Michael Jackson est mort d’une surdose d’un anesthésique, le Propofol. Le héros du roman est tenté de suivre son exemple.
Odelette
Pour ressembler à Michel Jacquesonne,
Attendre sans souci qu’un réveil sonne :
En nous couchant, avalons un plein bol
De propofol !
Si par malheur le témesta nous fâche,
Que notre cher pavot un jour nous lâche :
Vive la haute chope, sans faux col,
De propofol !
Oui ! grâce à toi nos nuits seront heureuses !
Oui ! trois fois oui ! Douces intraveineuses
De ce nectar, qui nous arrache au sol :
Le propofol !
Puisque après tout elle est triste, la vie,
Oublions-la dans cette anesthésie,
Faisons partout l’éloge sans bémol
Du propofol !
On blâmera, je sais, mon odelette,
On la dira criminelle et simplette,
Qualifiant mon propos de propos fol,
Ô propofol…
Mais tant qu’un bon docteur me la procure,
De ces blâmes amers je n’aurai cure,
Préférant à la blanche et à l’alcool
Le propofol.
Vers la poussière (2010)
Ont suivi, chez le même éditeur, deux autres livres. Un roman, Mathusalem sur le fil, qui est plutôt un recueil de nouvelles déguisé en roman, et interroge le lecteur sur la place bientôt hégémonique de l’image dans notre vie, et sa lutte inégale avec l’écrit. Puis un recueil de micro-nouvelles, Une Grosse, qui rassemble 144 très courtes fictions écrites et publiées sur le blog en 144 jours.
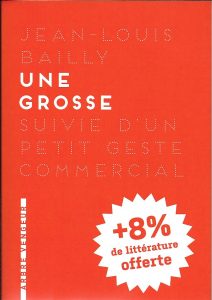
Entretemps est paru, chez un minuscule éditeur du Sud-Ouest, un roman écrit quelques années plus tôt, Un Divertissement, dont le décor est bien connu des professeurs de français : l’oral du baccalauréat de première. Le personnage, frappé par un deuil particulièrement insupportable, trouve dans l’oral du bac le moyen de se « divertir » de sa douleur. L’éditeur, Louise Bottu, en a vendu quelques centaines – très peu, donc, mais considérablement plus que de la plaquette qu’il a aussi publiée, La Chanson du Mal-aimant, « traduction » holorime, sans la lettre e, de « La chanson du Mal-aimé » d’Apollinaire…
Depuis, notre auteur continue d’écrire. Quelques romans sont achevés. Plusieurs éditeurs lui en ont dit grand bien. Il préférerait qu’ils en pensent un peu moins de bien, mais qu’ils les publient…
Si l’on trace le schéma de cette « carrière », force est de reconnaître que sa ligne se tourne vers les abîmes de l’oubli plutôt que vers le firmament de la gloire littéraire… Notre personnage ne cessera pas d’écrire, sans doute. Peut-être même proposera-t-il encore, de plus en plus mollement, ses tentatives à des éditeurs, qui les refuseront avec de moins en moins de précautions oratoires. Espérons que cet auteur conserve assez de lucidité pour ne pas sombrer dans une obstination sénile…
Il approche donc peu à peu malgré lui la forme de sagesse qui consiste à ne pas encombrer les rayons de la bibliothèque municipale de Nantes, entre autres, de livres dont l’humanité est jusque-là parvenue sans mal à se passer, et à préférer relire quelques classiques inépuisables ; à suivre le travail des auteurs vivants qu’il aime ; à en découvrir quelques-uns, aussi, qui ne programment pas leurs piètres best-sellers en vue du film qu’on pourrait en tirer, mais continuent de croire aux vertus d’une littérature exigeante et savent encore l’illustrer.

